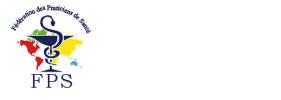Les députés rétablissent la régulation préalable à l'installation
Supprimée en commission, la mesure sur l’autorisation d’installation délivrée par les ARS est votée en séance publique par les députés. Une piste que ne privilégie pas le Gouvernement, qui préconise de supprimer le numerus apertus.
« La régulation n’est pas la coercition. Le principe de liberté d’installation prévaut. Il est inchangé pour 87% du territoire », rassure Guillaume Garot, le 2 avril, à la tribune de l’Assemblée nationale. Député Socialistes et apparentés de Mayenne, il est rapporteur d’une proposition de loi transpartisane sur les déserts médicaux qui divise les parlementaires en deux camps sur la régulation de l’installation — les représentants des médecins sont, eux, vent debout (voir la deuxième partie du dossier). À l’inverse de l’examen en commission, les partisans de l’autorisation préalable à l’installation ont été majoritaires en séance publique.
La mesure proposée dans le texte initial est donc rétablie, complétée (elle concerne les médecins libéraux comme les salariés) et votée. Son adoption définitive, avec le vote ou non de l’ensemble de la proposition de loi, ne sera possible qu’à partir du 6 mai, date de la reprise de l’examen suspendu à minuit. Les députés présents n’ont, en effet, examiné que ce premier article du texte, ainsi que quelques éléments complémentaires. La proposition de loi contient des mesures plus consensuelles comme la possibilité de suivre une première année de médecine dans chaque département. Un autre sujet sera sûrement très débattu entre les députés, celui sur le rétablissement de la permanence des soins pour les médecins salariés et libéraux.
Visions opposées sur les effets
Le modèle de régulation préalable est celui en vigueur depuis le début de l’année pour les chirurgiens-dentistes. Dans les zones les plus dotées, soit 13% du territoire pour les médecins, l’installation d’un nouveau praticien sera conditionnée à la cessation d’activité d’un autre. Pour les 87% du territoire restant, l’installation sera possible de droit, sans demander l’accord de l’ARS — un nouvel indicateur, introduit par amendement, permettra une meilleure identification du zonage. « Quand les déserts médicaux avancent, c’est la République qui recule », clame Guillaume Garot. Du côté des partisans de la mesure, Philippe Vigier (Les Démocrates, Eure-et-Loir), souligne que la densité médicale ne chutera pas dans les 13% de zones les plus dotées, puisqu’un médecin viendra toujours prendre la place de celui qui retire sa plaque. Un « jeu à somme nulle », à son sens. « La régulation n’est pas la coercition mais constitue l’essence même du respect de l’égalité, valeur qui fonde notre pacte républicain », estime Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine, Cher). Il cite le Premier ministre François Bayrou, qui, le 1er avril devant le Conseil économique, social et environnemental, a assuré qu’il « faut une régulation, comme l’ont décidé, conscients de la difficulté, nombre de professions de santé ».
Les soutiens du Gouvernement à l’Assemblée nationale sont les premiers opposants à cette proposition de régulation. Pour Stéphanie Rist (Ensemble pour la République, Loiret), la France est « en retard d’une guerre » avec cette mesure. Elle pointe une « fausse bonne idée » en rappelant qu’il n’existe pas de zones surdotées où il serait possible de refuser l’installation de nouveaux médecins. « Votre vision étriquée et hyperadministrée oublie les voies de contournement possibles : les étudiants trouveront toujours le moyen de s’installer où ils veulent », poursuit-elle en évoquant des départs à l’étranger ou dans des structures privées. Thibault Bazin (Droite républicaine, Meurthe-et-Moselle) pose, lui, plusieurs constats, comme le besoin de 2,3 jeunes médecins pour remplacer un départ à la retraite et le « virage vers l’exercice salarié ou mixte » puisque l’exercice libéral n’attire plus que 12% des étudiants. Il préconise un choc d’attractivité et fait part de solutions alternatives à la régulation comme le développement de l’assistanat territorial.
Fin du numerus apertus voulue par Yannick Neuder
Une solution également rappelée par le ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, Yannick Neuder. Il promet l’arrivée, en novembre 2026, de 3 700 docteurs juniors dans les territoires. « Il faut se rendre à l’évidence qu’une pénurie de médecins, même régulée, restera une pénurie », souligne-t-il à propos de l’autorisation préalable d’installation. À son sens, l’enjeu est de former plus pour répondre au problème sur le long terme et de trouver des solutions sur le court et moyen terme, comme la sécurisation de l’exercice des praticiens diplômés en dehors de l’Union européenne. « Je ne crois pas que nous pouvons gérer la ressource humaine médicale sans tenir compte de l’adhésion des professionnels aux mesures proposées », met-il en garde.
En matière de formation, il insiste sur la nécessité de se « libérer définitivement de la contrainte du numerus apertus ». Introduit avec la suppression du numerus clausus, il correspond à un plancher du nombre de places en formation — plancher qui est aussi souvent un plafond en raison du manque de moyens dans l’enseignement supérieur. Il appelle à une nouvelle logique, en identifiant les besoins de santé d’abord pour déterminer les capacités locales de formation. Le ministre milite aussi pour le retour des étudiants qui partent se former à l’étranger. Dans son discours préalable, Yannick Neuder met par ailleurs l’accent sur l’exercice coordonné et le développement de la pratique avancée infirmière.
« Une grande partie de la solution au problème dont nous débattons se trouve entre les mains » des acteurs de santé, résume-t-il. Le ministre annonce aux députés, qu’à la demande de François Bayrou, il a ouvert des concertations sur l’ensemble du mois d’avril centrées sur le fonctionnement du système de santé. Le périmètre des personnes invitées comprend des médecins et des internes mais aussi des doyens de facultés, des patients et les ARS. Si le texte de loi est adopté au Parlement, Yannick Neuder prévoit également une concertation, cette fois sur la rédaction du décret d’application qui concernera les élus, les étudiants et l’ordre des médecins.
Le Sénat et les étudiants en médecine proposent tour à tour des alternatives
Dans le contexte polémique d’une possible régulation de l’installation, une nouvelle proposition de loi est déposée au Sénat. Elle apporte plusieurs précisions et dérogations. Les internes et étudiants ont quant à eux rédigé un texte prêt à l’emploi.
Outre une vive opposition des médecins libéraux à la proposition de loi pourtant transpartisane, les derniers jours ont été marqués par l’émergence de deux textes alternatifs. La première proposition est officielle, elle est portée par le sénateur Philippe Mouiller (Les Républicains, Deux-Sèvres) et vise à améliorer l’accès aux soins dans les territoires. La seconde, non déposée encore par un parlementaire, a été rédigée par les étudiants et internes (lire l’encadré).
De nouvelles mesures…
La proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires a été déposée au Sénat le 28 mars. Elle part du postulat que « les problèmes d’accès aux soins ambulatoires exigent des mesures fortes, justes et efficaces à court comme à plus long terme ». Le texte porte des mesures ayant pour objectif d’apporter des réponses « en faveur d’un meilleur aménagement sanitaire du territoire ». Philippe Mouiller entend ainsi « réaffirmer le caractère libéral de la médecine française et de la liberté de choix des patients » et prône « un principe de souplesse » ainsi qu' »une juste rémunération ». La proposition de loi explicite également le principe de la coordination des soins.
… et des dérogations
Concrètement, le texte vise plus particulièrement à renforcer l’offre de soins dans les territoires sous-dotés. Si cette proposition de loi maintient le principe d’une autorisation préalable pour l’installation des médecins libéraux, elle préconise de la conditionner, pour les généralistes exerçant en zone sur-dense, à un engagement d’exercice à temps partiel en zone sous-dense. S’agissant des spécialistes, cette autorisation serait conditionnée, en zone sur-dense, à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant sur le même territoire. Cette condition ne s’appliquerait pas dans deux cas : lorsque le médecin s’engage à exercer à temps partiel dans une zone sous-dotée ; et à tire exceptionnel sur décision du directeur général d’ARS lorsque l’installation est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins sur le territoire.
Un article propose en outre d’autoriser les médecins à pratiquer des dépassements d’honoraires en zone sous-dense, dans des conditions fixées par la convention médicale. Contrat à durée indéterminé dans les centres de santé, reconnaissance du rôle des praticiens à diplôme hors Union européenne ou encore mise en place d’outils d’évaluation des besoins en matière de temps médical « au plus près des territoires et avec les élus locaux » sont aussi détaillés dans le texte. À noter également que cette proposition envisage la création d’un office national d’évaluation ayant vocation à remplacer l’actuel Observatoire national de la démographie des professions de santé.
D’autres mesures visent à libérer du temps médical — en favorisant par exemple la pratique avancée infirmière — ainsi qu’à améliorer l’information du Parlement et des citoyens sur l’impact des actions en faveur de l’accès aux soins. Cette proposition de loi sera discutée en première lecture au Sénat le 12 mai prochain.
Un texte "prêt à l'emploi"
Dans un communiqué transmis le 27 mars, l’Association nationale des étudiants en médecine de France, le Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants et l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale dévoilent le contenu de leur proposition de loi. L’objectif ? « Améliorer enfin l’accès aux soins », écrivent les étudiants. Ils formulent en ce sens une proposition comprenant quatre chapitres et quatorze articles. L’idée est d’agir conjointement sur l’ensemble des leviers à disposition. Il est ainsi question de libérer du temps médical ; d’accompagner les étudiants et jeunes professionnels ; d’agir sur la prévention et de préciser le rôle des collectivités locales en tant que soutien des professionnels. Création d’antennes universitaires, plus de stages en ville, transfert de certaines missions à d’autres professions de santé ou encore facilitation du travail en équipe sont quelques-unes des mesure portées. « Il ne sera désormais plus entendable d’accuser les jeunes de s’opposer sans proposer d’actions concrètes, alors qu’ils n’ont eu de cesse de présenter leurs solutions communes ces dernières années », souligne les structures, invitant les parlementaires à se saisir de ce texte « prêt à l emploi « .
Publié le 03/04/25 – Hospimedia